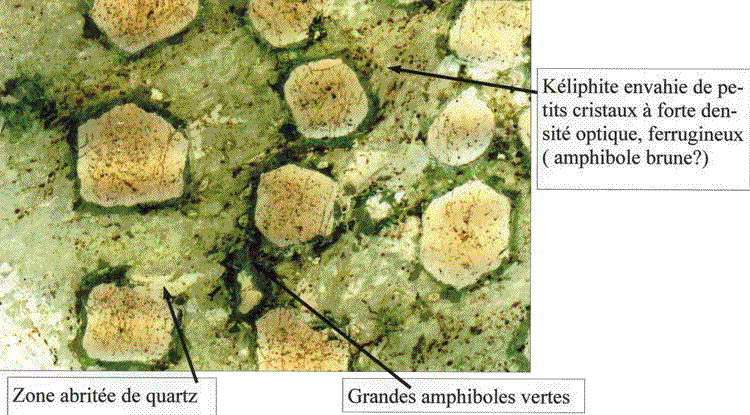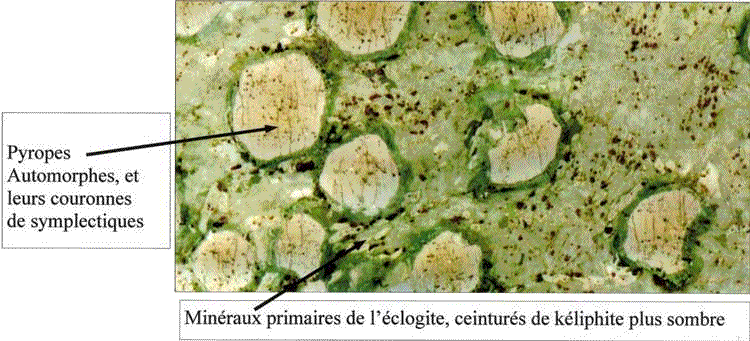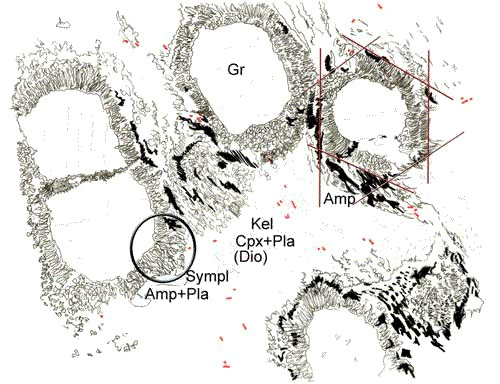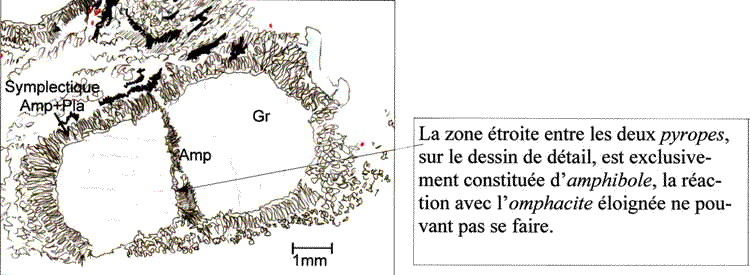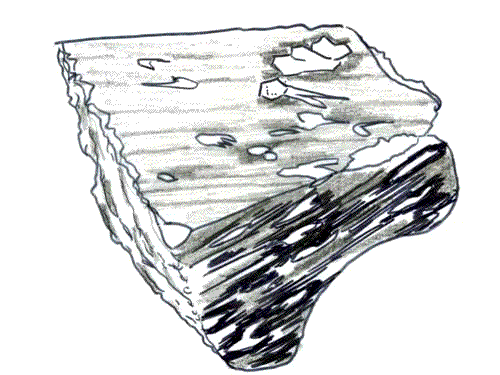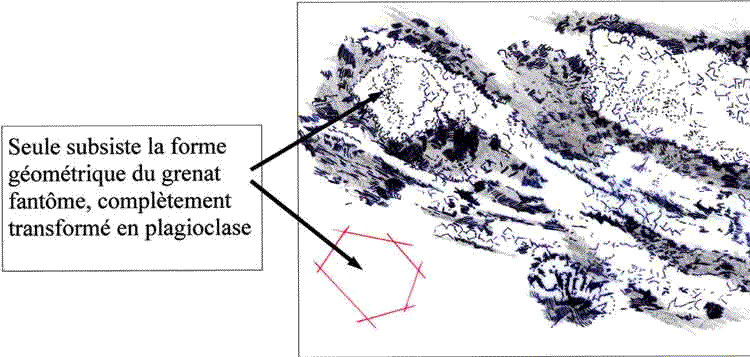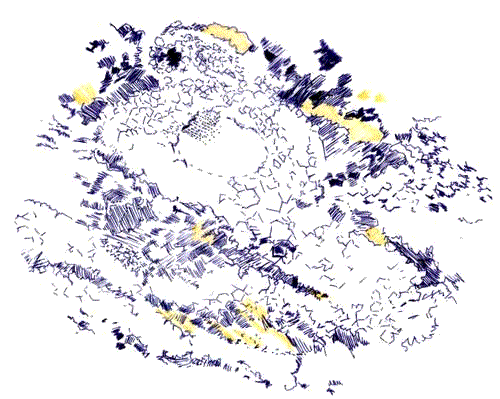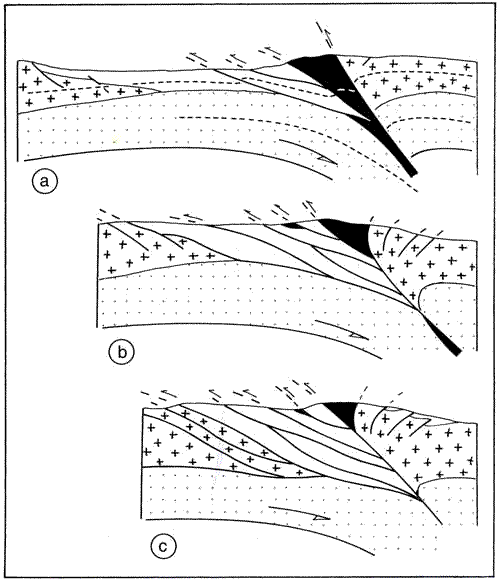L’interprétation se fait plus aisément sur la lame mince taillée sur le même échantillon d’éclogite : planches 12 et 13. On observe plus nettement l’étroite couronne verte de symplectite qui ceinture tous les pyropes ; certains présentent de petits golfes de corrosion. La trame de la matrice est si fine qu’elle n’est pas résolue : il s’agit d’une kéliphite, qui résulte de la recristallisation de l’omphacite rendue instable, et qui a disparu. C'est une association digitée complexe des produits de recristallisation, qui sont l’amphibole verte et le plagioclase acide. Elle est organisée en cellules globuleuses ou allongées, de largeur de l’ordre de 0,1mm, disposées parallèlement les unes aux autres pour former un rubanement orienté dans la même direction. Quelques–uns des minéraux primaires ( disthène, zoïsite )de l’éclogite subsistent à l’état de reliques et sont finement ceinturés d’un liseré de kéliphite plus sombre ; ces reliques sont très allongées dans le sens du rubanement.
La matrice de kéliphite est ponctuée d’innombrables amphiboles brunes en prismes courts, qui parfois s’alignent suivant les lignes de flux du rubanement.
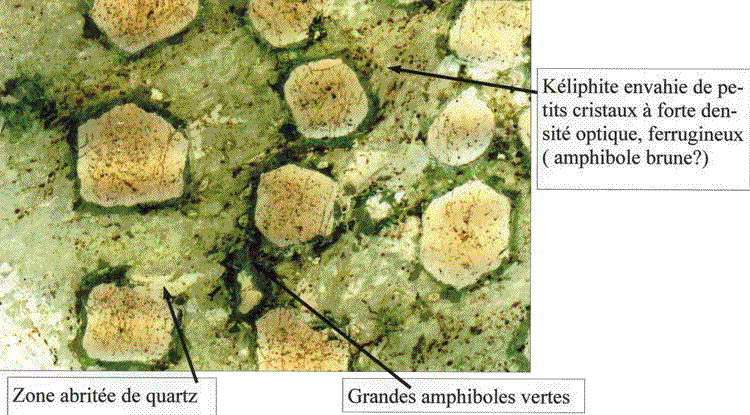
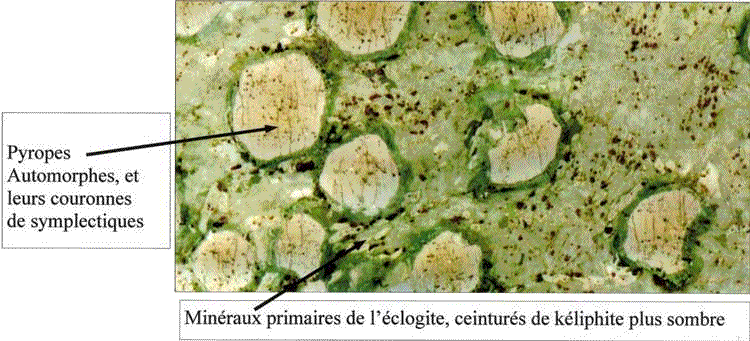
Planches 12 et 13: Lames minces taillées sur des éclogites en début de rétromorphose.
Lumière naturelle
Sur le terrain, on observe toute la gamme des transformations de l’éclogite primitive, d’abord par kéliphitisation puis amphibolisation de plus en plus poussée. La planche 14 est prise sur une lame mince taillée dans une éclogite ou l’amphibolitisation a commencé à la périphérie de la couronne symplectique. Cette dernière est bien développée et l’interdigitisation des microcristaux concentriques de plagioclase avec ceux d’amphibole est visible et renforcée sur les dessins d’interprétation associés : planches 15 et 16.
 |
Planche 14
Les pyropes sont entourés de deux couronnes, la première étant un symplectite, la seconde de grandes amphiboles vert sombre, entraînées dans le rubanement.
L’omphacite est déstabilisée en kéliphite composée de très fins cristaux de diopside et de plagioclase entremêlés.
Lumière naturelle |
Planches 15 et 16: dessins d’interprétation de la photo de la planche 14. Les traits rouges soulignent les contours géométriques du pyrope primitif, avant rétromorphose. |
|
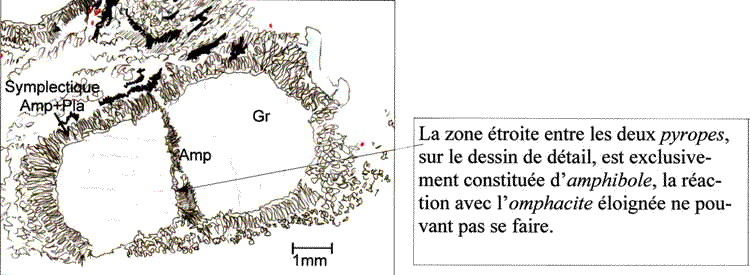
Le stade ultime d’amphibolitisation est observé dans un autre corps de métaéclogite : le Puy d’Arial, dans le forêt de Blanchefort : planche 8. Avec le développement de l’amphibole verte, la métaéclogite devient sombre. Les grenats deviennent de plus en plus petits et une couronne plagioclasique blanche ( andésine ) apparaît, qui finit par les envahir complètement : planche 17. Le diopside disparaît complètement au profit de la hornblende. La texture devient granulaire, mais en même temps, la schistosité se développe, comme on peut l’observer sur la photo 19, faite sur la surface polie d’un échantillon du Puy d’Arial, dessiné planche 18. Il s’agit d’une amphibolite, quasi banale, à nodules plagioclasiques de grande taille, qui retiennent encore la forme géométrique de gros grenats complètement transformés. Le cœur des nodules est occupé par un granule relique d’un minéral à fort relief non identifié, avec une zone concentrique formée d’une mosaïque équante de grains polygonaux de plagioclase. Planches 20 à 23.

Planche 17: éclogite amphibolitisée, de Puy d’Arial, à texture finement granulaire.
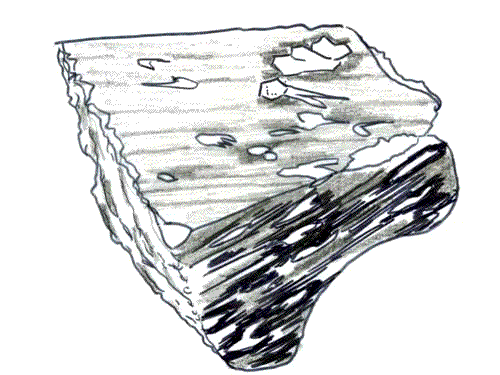 |
Planche 18:
Schistosité sur un bloc de métaéclogite amphibolitisée, à nodules plagioclasiques. |
Planche 19: face polie parallèle au plan de schistosité de l’amphibolite à nodules plagioclasiques. |
|

|
Planches 20 à 23 Métaéclogite du Puy d’Arial, complètement transformée en amphibolite à nodules plagioclasiques.
Texture granoblastique de recuit. |
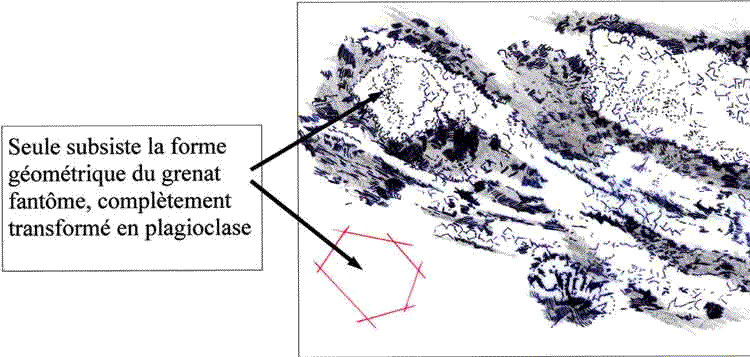
 |
Nodule en forme d’amande de plagioclase sur un fond rubané de
hornblende, de feldspath et de quartz.
L’amande est constituée d’un gros noyau monocristallin entouré d’une écorce formée d’une mosaïque équante de grains polygonaux, à joints à 120°.
Dessin interprétatif. |
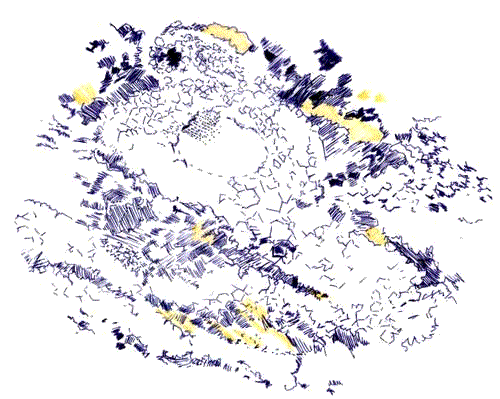
Nota sur les « amphiboles brunes »,
mentionnées plus haut, à propos des planches 12 et 13.
Au fur et à mesure que la rétromorphose progresse, la fraction aegyrine ( NaFe(SiO3)2) de l’omphacite déstabilisée se sépare et réagit pour former des produits de réaction ferrugineux, qui opacifient en partie la kéliphite. Certains auteurs ont identifié, dans ces produits de réaction, ce qui est communément appelé « amphibole brune » et qui paraît fortement colorée, en lame mince examinée en lumière naturelle, avec pléochroïsme intense dans les bruns , brun rouge. Elle fait partie des amphiboles sodocalciques :
Na Ca2 (Mg, Fe, Mn)5 ( Al1,5 Si6,5 O22 (OH)2)
On la trouve surtout dans les basaltes ( « amphibole basaltique » ) mais aussi dans les roches ultrabasiques, d’après M.Roubault: « détermination des minéraux des roches »…
En conclusion, rappelons le paradoxe de la présence de ces roches reliques de haute pression, étrangères à priori au contexte général de la région métamorphique du Bas-Limousin! Le paradoxe est levé en considérant que ces corps de métaéclogites ne doivent pas être compris dans une logique stratigraphique, mais comme des écailles d’un épisode précoce ( Ordovicien-Silurien), reprises dans les semelles tectoniques au cours du cycle hercynien. Elles en sont donc séparées par des contacts anormaux : planche 23 bis.
Planche 23 bis
(a): le biseau continental s’insère dans la subduction à la suite de la croûte océanique.
(b):le manteau lithosphérique poursuit son mouvement de subduction. Les écailles du manteau continental s’empilent les unes sur les autres. C’est le « sous-charriage ».
© blocage de l’enfouissement. Les unités les plus hautes dans la structure ont subi les stades précoces d’enfouissement et une exhumation tectonique qui se traduit par des réactions rétrogrades.
D’après Kornprobst, ouvrage cité. |
|
|